Parutions
Les chercheurs à l’Université de Saskatchewan L. C. Guerra et K. S. Coates se fondent sur les données de l’OCDE et de la Banque Mondiale dans leur article paru dans The Conversation. Leur analyse montre que dans les pays de l’OCDE, 39 % des étudiants au baccalauréat obtiennent leur diplôme dans la durée prévue de leur programme, et 28 % l’obtiennent au cours des trois années suivantes.
Comment mesurer le taux d’abandon ?
Mesurer le nombre d’étudiants qui ne terminent pas leurs études n’est pas une tâche facile étant donné qu’il existe de nombreuses façons de définir et de calculer ce chiffre.
L’une des définitions les plus acceptées de l’abandon des études est celle selon laquelle l’étudiant n’obtient pas son diplôme dans un délai de 150 % du temps prévu : par exemple, trois ans pour un cours de deux ans ou six ans pour celui de quatre ans. Cette définition est toutefois critiquée car certains étudiants changent de programme ou d’établissement et obtiennent finalement un diplôme d’études postsecondaires.
De fait, au Canada, près de la moitié des étudiants des collèges et 62 % des étudiants universitaires qui quittent leur programme retourneront aux études postsecondaires dans un délai de trois ans, et ce, dans le même établissement ou dans un autre.
Sentiment d’appartenance
Selon les chercheurs, des études montrent que les étudiants de première année qui n’ont personne à qui parler de leurs problèmes personnels sur le campus et qui ont un faible sentiment d’appartenance sont plus susceptibles d’abandonner leurs études.
Le sociologue Wolfgang Lehmann, de l’Université Western, soutient que les étudiants de première génération et les étudiants à faible revenu ont souvent un sentiment de ne pas s’intégrer à l’université en raison d’un manque de liens sociaux.

Coûts des études
Au Canada, les étudiants mettent entre 9 et 15 ans à rembourser leur prêt. Un sondage Ipsos réalisé en 2017 révèle que 77 % des diplômés du collégial ou de l’université regrettent d’avoir contracté leur dette.
Le coût élevé des études signifie que de nombreux étudiants doivent travailler à temps plein ou partiel pendant leur formation. Or, trop travailler pendant ses études peut nuire au rendement scolaire.
Guerra et Coates font état d’une étude sur les profils de décrocheurs de l’enseignement postsecondaire au Canada qui révèle que les étudiants dont la moyenne en première année était de 60 % ou moins étaient deux fois plus susceptibles de décrocher que ceux dont la moyenne était supérieure à ce seuil.
Investissements ciblés
L’Université d’État de Georgie, à Atlanta (États-Unis), est un exemple de réussite dans l’augmentation des taux de diplomation : elle l’a fait de 22 % en dix ans en investissant dans des initiatives clés.
L’établissement a entre autres offert de petites subventions aux étudiants, parfois aussi peu que 300 $. Cette aide ad hoc s’est avérée particulièrement utile pour les étudiants plus âgés qui ont parfois des besoins immédiats. Un programme de conseil proactif a également été mis en place, permettant à des conseillers de suivre des étudiants tout au long de leurs études. Des petites cohortes de 25 étudiants de première année ont été créées, ce qui a consolider leur sentiment d’appartenance en début de parcours.
Consulter l’article complet dans The Conversation (en anglais)
Suggestions de lecture
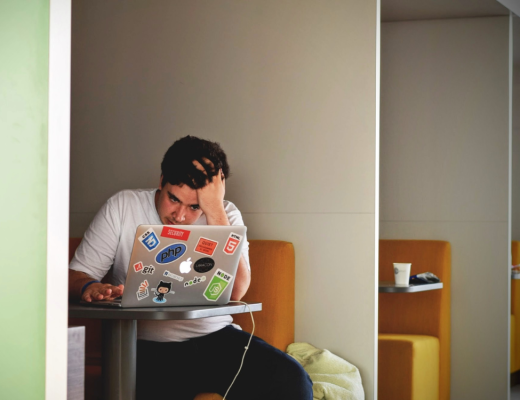
Santé mentale étudiante : coup d’œil sur les établissements d’enseignement postsecondaire en Ontario

Quelle place pour le développement de la citoyenneté numérique responsable au cégep ?

Récits de vie et réussite éducative

Encourager les étudiantes et étudiants internationaux à participer aux activités extrascolaires

Encourager l’accès des communautés noires aux professions de la santé

Les attentes des étudiants et étudiantes pour la rentrée

Pistes pour améliorer la pratique enseignante au collégial : inclusion, motivation et littératie | Publication

Vers un système de recherche plus accessible | Publication

Les approches holistiques de la réussite étudiante | Publication

