Résultats de recherche
C’est le cas de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), qui a publié dans le magasine Découvrir un dossier intitulé Femmes et sciences. L’un des articles présentés, Les femmes en sciences et génie : embûches et progressions, est signé par la chercheure Sophie Brière (Université Laval) et porte plus particulièrement sur les obstacles rencontrés par les femmes en sciences et génie. Les résultats présentés proviennent d’une recherche multidisciplinaire menée en 2015 sur la situation des femmes dans les métiers non-traditionnels.
Portrait des filles en sciences
Brière rappelle que si l’on note une certaine avancée du nombre d’inscriptions des filles dans les programmes de premier cycle en génie au Québec, la proportion d’inscriptions féminines a peu progressé dans la dernière décennie.
Le nombre de femmes inscrites en génie au premier cycle est passé de 2376 à 3882 de 2007 à 2015, soit une proportion, par rapport au nombre total d’inscriptions, passant de 16 % à 20 %.
Certains programmes de génie attirent davantage de filles que d’autres soient :
- génie alimentaire (59 %);
- génie biologique et biomédical (49 %);
- génie agricole et rural (46 %).
Toutefois, ces trois programmes ne comptent que pour environ 8 % du nombre total d’inscriptions en génie (hommes et femmes). Les trois programmes qui attirent les plus faibles pourcentages d’inscriptions féminines au premier cycle sont :
- génie informatique (10 %);
- génie électrique (11 %);
- génie mécanique (12 %).

Des actions entreprises
Certaines actions ont été entreprises pour augmenter le nombre de femmes inscrites dans les différents programmes de formation en sciences et génie (par exemple, PromoScience, Chapeau les filles et les Scientifines) et pour favoriser la rétention des filles une fois inscrites.
Selon la chercheure, les stages permettraient aux femmes de prendre conscience des biais sexistes à l’université et dans le milieu de travail. Les stages représentent également une occasion pour les organisations de revoir leurs pratiques d’accueil.
De leur côté, les établissements d’enseignement supérieur mettent également de l’avant l’aspect humain et la portée sociale du domaine, en faisant la promotion de nouvelles filières telles que les biotechnologies, l’environnement et le génie des eaux.
Une culture de performance
Ce portrait montre que, si la situation évolue, des changements structuraux et sociétaux importants sont toujours attendus, en particulier dans les pratiques des organisations.
Par exemple, dans le milieu universitaire, les femmes ayant de jeunes enfants ou celles voulant devenir parents sont désavantagées en raison de la culture académique axée sur la performance et la course à la publication.
Enfin, si des programmes/pratiques d’équité, de diversité et d’inclusion existent, elles vont parfois à l’encontre d’une culture bien ancrée dans le secteur, notamment celle de la performance.
S’il existe des mesures, le fait d’y recourir peut être perçu comme un manque d’engagement et donc nuire à la progression de la carrière.
Consulter l’article de Sophie Brière dans le magasine Découvrir
Suggestions de lecture

Comment mieux soutenir les personnes étudiantes autistes dans leur recherche d’emploi ?

L’importance de la motivation dans le choix de carrière | Résultats de recherche

Parcours scolaires de femmes autochtones | Résultats
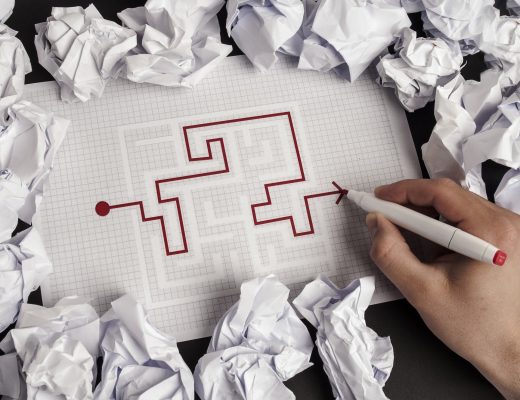
Regard rétrospectif sur les parcours scolaires, professionnels et personnels de jeunes francophones ayant étudié dans un cégep anglophone | Résultats

Parcours en enseignement supérieur | Résultats

Pourquoi les jeunes femmes boudent-elles les STIM ? | Publication

