Résultats de recherche
Chaque année, le Consortium for Student Retention Data Exchange (CSRDE) de l’Université de l’Oklahoma organise un symposium, le National Symposium on Student Retention (NSSR). Le symposium accueille virtuellement, en raison de la pandémie, les établissements membres du CSRDE, comme l’Université du Québec, afin qu’ils partagent leurs pratiques inspirantes en matière de réussite scolaire (analyses de données, exemples de projets et d’outils, etc.)
Sylvie Bonin a écrit cinq fiches synthèses qui rendent compte d’initiatives ou de stratégies de réussite étudiante qui se sont démarquées lors du dernier NSSR (10 au 13 novembre 2020). Ces fiches, inspirées d’une traduction libre de présentations en anglais, témoignent de la compréhension subjective mais éclairée de Sylvie Bonin concernant les communications auxquelles elle a assisté en tant que représentante de l’UQ. Deux des cinq fiches font l’objet d’une brève présentation dans cet article.
Fiche 1 : « Existe-t-il un point de comparaison nord-américain pour le taux de diplomation à la maîtrise ? »
Depuis 2007, l’Université du Québec est membre du CSRDE, et participe chaque année à leur collecte concernant les taux de diplomation des étudiant·es au baccalauréat à temps complet. Le rapport produit par le CSRDE permet de comparer les taux de diplomation du réseau de l’UQ à ceux des autres universités nord-américaines participantes (plus de 300 universités). Cette contribution de l’UQ au CSRDE permet de positionner le réseau dans l’enseignement supérieur nord-américain.
Cela dit, les taux pour les cycles supérieurs manquent aux États-Unis, contrairement au Québec, à défaut d’une définition commune et d’un outil centralisé. Bonin a retenu, lors du dernier symposium, l’analyse de James R. Stefanelli qui portait sur les taux de diplomation à la maîtrise dans quatre universités américaines : « Master’s Student Degree Completion : A Statistical Analysis of Master’s Student Retention, Graduation Rates, and Time to Degree ».
Stefanelli s’appuie sur la « cohorte de 2009, suivie pendant 10 ans (plus de 4 000 étudiant·e·s de maîtrise) », selon une précision de Bonin. Ce qui distingue la présentation de Stefanelli serait les liens établis entre la « persévérance à la maîtrise et diverses caractéristiques au moyen de régressions logistiques » (Bonin, 2021a).
Les chiffres de l’analyse de Stefanelli en bref
« Taux de diplomation des quatre universités participantes sont respectivement de 79 %, 84 % et 86 % après 4, 6 et 10 ans, avec une durée moyenne des études de 2,4 ans. Conformément aux études québécoises, des taux de diplomation plus élevés sont observés pour les étudiant·e·s qui débutent leur programme au trimestre d’automne (87 %) comparativement à celui d’hiver (80 %), à temps complet (89 %) par opposition au temps partiel (77 %) et pour les maîtrises professionnelles (87 %) relativement aux maîtrises de type recherche (81 %). Des variations significatives sont également notées selon la discipline d’études et la diplomation tend à diminuer avec l’âge d’entrée à la maîtrise. »
Bonin (2021a)
Fiche 2 : « Comment préparer nos étudiantes et étudiants à suivre une formation à distance (FAD) ? »
Dans cette fiche, Bonin présente les travaux d’Amanda Phillips « Promoting Online-Learning Preparedness in the Community College Setting » sur l’approche de Guilford Technical Community College (GTCC) dans son séminaire de préparation aux études à distance, intitulé Online Success Seminar.
Il s’agit donc d’un séminaire obligatoire de préparation à la formation à distance (FAD) d’une durée de 30 à 45 minutes qui a été conçu pour augmenter le taux de réussite des cours en ligne au Collège. Le séminaire initie les étudiant·es à la plateforme Moodle et tente de leur inculquer les rudiments de la FAD.
Précisément, l’objectif du séminaire consiste à familiariser la personne avec l’environnement d’apprentissage et les outils technologiques utilisés par l’établissement avant qu’elle ne commence son premier cours en ligne. Elle y apprend, par exemple, comment se présenter et participer à un forum de discussion, la nétiquette et les règles concernant la tricherie et le plagiat. Les façons de naviguer à travers les documents d’un cours, de télécharger des outils, d’acheter un manuel scolaire à la librairie en ligne et de s’inscrire à un cours sur le portail de l’établissement sont également abordées. En somme, le séminaire permet à l’étudiant·e de réfléchir (autoévaluation) à son degré de préparation aux études à distance, lui permettant d’agir rapidement, si cela est requis, afin de solidifier ses assises. La note de Bonin (2021b) offre une présentation détaillée du contenu du séminaire.
Bien qu’ayant obtenu des résultats modestes en matière de retombées – le séminaire a permis d’augmenter le taux de réussite des cours en ligne de 4 % –, le Collège a choisi de maintenir le séminaire et souhaite ajuster quelques paramètres, notamment de revoir la durée et de rendre le contenu plus dense, selon Bonin.
Sources : Bonin, S. (2021a). Existe-t-il un point de comparaison nord-américain pour le taux de diplomation à la maîtrise ? Québec : Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec.
Bonin, S. (2021b). Comment préparer nos étudiantes et étudiants à suivre une formation à distance (FAD) ? Québec : Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec.
Bonin, S. (2021c). La COVID-19 a-t-elle affecté nos stratégies de rétention et notre façon de mesurer la réussite ? Québec : Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec.
Bonin, S. (2020a). Le « Jeu-questionnaire 70/70 », un outil d’enseignement efficace ? Québec : Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec.
Bonin, S. (2020b). Communication, avez-vous dit : « Communication » ? Québec : Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec.
Pour plus d’informations sur le Consortium for Student Retention Data Exchange (CSRDE).
Pour obtenir les ressources (liste des participants, programmation et actes du symposium) du National Symposium on Student Retention 2020 (NSSR).
Suggestions de lecture

Facteurs d’abandon aux cycles supérieurs

La compétence en écriture : quel rôle pour les personnes enseignantes au collégial?
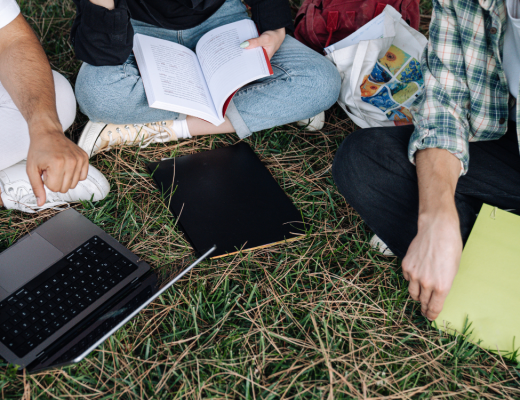
Comment « apprendre à apprendre » ?

Hyperconnectivité et résignation numérique chez les populations étudiantes

Étudier en prison

Comment favoriser la persévérance dans les CLOM?

S’investir dans ses apprentissages grâce aux balados

Premiers soins en santé mentale : des compétences à développer dans la population étudiante

Mobilité étudiante : l’effet du moment et de la durée du séjour




