Parutions
Cet article est publié en avril 2016 dans un numéro spécial de la revue L’empan qui porte sur le thème de la maladie mentale. Les auteurs, Marc-André Gosselin et Robert Ducharme, y abordent la problématique grandissante de l’anxiété sur les campus collégiaux au Québec.
L’article rédigé par MM. Gosselin et Ducharme découle d’une recherche menée auprès de 12 208 étudiants et étudiantes provenant de huit cégeps et porte sur leur utilisation des services d’aide et leurs besoins psychoaffectifs. Il s’agit d’une thématique qui a d’ailleurs déjà fait l’objet d’un webinaire du CAPRES auquel avaient participé les deux auteurs (7 octobre 2015).
Les objectifs de l’enquête
L’enquête, réalisée dans huit cégeps, avait deux objectifs principaux. Dans un premier temps, il s’agissait de mesurer le recours aux services d’aide (pour les difficultés psychoaffectives) chez les cégépiens et cégépienne de l’enseignement ordinaire. Dans un deuxième temps, l’enquête souhaitait identifier les facteurs qui motivent ou nuisent à l’utilisation de ces services, selon l’âge, le sexe, le programme d’études, les groupes ethniques et les cégeps.Méthodologie
C’est la plateforme en ligne «Omnivox» qui a été employée afin de permettre aux participants de remplir le questionnaire. La période pour y répondre a été de quinze jours, à partir du 15 novembre 2014. L’anonymat était garanti aux personnes répondant au questionnaire. Les auteurs ont eu recours à l’«Échelle de changement de vie de Holmes et Rahe» (1967) et à l’«Inventaire d’anxiété de Beck» (1992) en prenant soin d’apporter les adaptations nécessaires à ces outils.La consultation des services par les cégépiens et cégépiennes
Selon le sondage, ce sont 72,9 % des personnes ayant répondu qui ont consulté pour des difficultés personnelles autres que celles liées à la dimension scolaire. Parmi les personnes consultées par les étudiants, on note les suivantes :- Professeur (58,1 %)
- Aide pédagogique (49,7 %)
- Conseiller d’orientation (24,1 %)
- Agent de sécurité (19,8 %)
- Infirmière (17,8 %)
- Psychologue (8,5 %)
- Service d’aide spécialisée (8,3 %)
- Travailleur social (6 %).
La détresse et l’anxiété au cœur de la recherche
La détresse et l’anxiété ont constitué les deux variables psychoaffectives étudiées. Dans le cas de la détresse, les auteurs mentionnent que la moyenne obtenue pour cette variable indique un niveau de détresse relativement faible. Les facteurs contribuant le plus au niveau de détresse sont le rejet, l’humeur dépressive, le handicap physique, la pression liée à la performance scolaire et les conflits familiaux. En ce qui concerne l’anxiété, six énoncés ressortent de façon significative comme contribuant au niveau d’anxiété. La sensation soudaine de panique ainsi que l’impression de ne pas être à la hauteur des idéaux de réussite sont des éléments d’importance pour expliquer le niveau d’anxiété chez les cégépiens et cégépiennes. Notons également chez eux la difficulté à se détendre, l’impression de ne pas être aimé pour ce qu’ils sont réellement, la tendance à se faire du souci et les nausées, douleurs ou malaises d’estomac. Gosselin et Ducharme mentionnent que les pensées suicidaires méritent de l’attention puisque 7,3 % des répondants et répondantes disent en avoir «souvent» ou «tout le temps». Selon les auteurs, ces pensées sont fortement corrélées avec les scores de détresse et d’anxiété qu’ils ont mesurés. Néanmoins, les personnes ayant le plus de pensées suicidaires ne consultent pas plus pour autant. Les auteurs de l’étude y voient un possible effet inhibant d’un niveau de souffrance élevé lié à la détresse et l’anxiété. Ils soulignent néanmoins qu’il y a une corrélation significative entre la consultation des ressources d’aide à l’interne et le score de détresse ou celui d’anxiété.Les préjugés en santé mentale
Les auteurs de l’article relèvent six énoncés qui ressortent de façon significative comme contribuant au score global de l’échelle qu’ils ont utilisée.- «Les maladies mentales touchent surtout des personnes âgées, pauvres et avec un niveau d’instruction peu élevé»
- «Les personnes atteintes d’un problème de santé mentale ne peuvent pas être aux études ou sur le marché du travail»
- Les personnes atteintes d’un problème de santé mentale manque de volonté pour s’en sortir»
- «Consulter une ressource d’aide ne peut pas contribuer à mon épanouissement personnel»
- «Si on me disait atteint d’un problème de santé mentale, je ne l’accepterais pas»
- «Il y a beaucoup moins à espérer de la vie après avoir été atteint d’un problème de santé mentale»
Une grande conclusion
Pour Gosselin et Ducharme, une grande conclusion s’impose au terme de leur étude. Il est nécessaire d’offrir des services d’aide aux cégépiens et cégépiennes qui éprouvent des difficultés personnelles d’ordre psychoaffectif.Suggestions de lecture
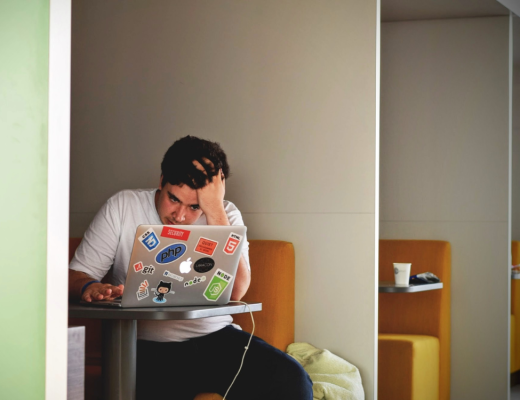
Santé mentale étudiante : coup d’œil sur les établissements d’enseignement postsecondaire en Ontario

Santé mentale étudiante et changements climatiques

Cadre de référence sur la santé mentale étudiante | Publication

Résilience en temps de pandémie | Publication

Quand l’anxiété devient contagieuse | Publication

10 stratégies de soutien à distance | Publication

Isolement des étudiants | Publication

Norme sur la santé et la sécurité psychologiques | Demande de rétroaction

Anxiété et incertitude | Publication
